Fuir la Suisse, cette cage dorée
Portraits d'expatriés helvétiquesFuir la Suisse, cette cage dorée
Niklaus Mueller
Esprit d'entreprise La passion chinoise de NiklausSusan Misicka (texte), Daniele Mattioli (photos)
Niklaus Mueller Etudes chinoises
Niklaus Mueller Etudes chinoises


Pour Niklaus Mueller, 32 ans, la Chine est le pays où il faut être. Il y séjourne pour la 3e fois en cinq ans. Comme de nombreux Suisses de sa génération, il veut explorer le monde et utiliser cette expérience à son avantage.
«Beaucoup de mes amis voulaient aller à l'Ouest. Moi je voulais repartir à l’Est. Je suis fasciné par la Chine, et même si j’avais déjà passé plus de deux ans là-bas, je voulais approfondir ma compréhension du pays et de sa place dans l'économie mondiale», raconte le jeune homme.
Très bien habillé, ses notes en main pour l'entrevue, Niklaus Mueller explique qu’il a pris goût à la Chine lors d'un stage dans un cabinet international d'avocats, CMS, en 2011. Il a dû retourner à Zurich en 2012 pour terminer ses études d’avocat. Mais la Chine n’a pas quitté son esprit.
«J’étais déjà convaincu qu’il fallait trouver un moyen de revenir en Chine», se souvient Niklaus Mueller. De retour à Shanghai, CMS lui a offert la chance de lancer sa carrière en tant qu'associé à temps plein. Ce qu'il a fait pendant deux ans, avant de travailler pour Credit Suisse à Zurich. Mais après une année, l’envie de Chine est remontée. Il s’est inscrit à un programme MBA à la China Europe International Business School (CEIBS) en 2015.
«Je suis très intéressé par l'esprit d'entreprise et l'innovation, et compte tenu de l'évolution actuelle de la Chine, je pense que c’est l'un des endroits les plus excitants où vivre», explique Niklaus Mueller, originaire de Berne.
Cette passion pour l’Empire du Milieu englobe sa culture, son histoire et sa langue, le mandarin qu’il étudie assidument. Prochaine étape, la maîtrise de 2500 caractères.

Galerie de photosUn étudiant bernois à Shanghai
(Images: Daniele Mattioli)
Le filet de sécurité suisse
Le filet de sécurité suisse


Le filet de sécurité suisse
En parlant de caractère, Niklaus Mueller est clairement un ambitieux. Ce qui lui a permis de sortir de la «cage dorée» que constitue la Suisse.
Dans le même temps, il reconnaît et salue la stabilité politique et économique de la Suisse: «Nous avons le luxe de pouvoir nous aventurer à l'étranger et si cela ne fonctionne pas, nous pouvons toujours revenir en Suisse. Je suis assez sûr de trouver un emploi en quelques mois si je devais rentrer chez moi. Cela rend l’expatriation beaucoup plus légère.»
Tout le monde ne jouit pas d’un tel filet de sécurité. Niklaus Mueller cite l'exemple d'une collègue espagnole qui a dû rester en Chine parce qu'elle avait du mal à trouver du travail en Espagne.
Les perspectives en Chine sont plutôt bonnes, en particulier pour les Suisses, selon l’avocat: «Les entreprises chinoises sont présentes dans toute l'Europe et le reste du monde. Avec l'accord de libre-échange signé entre la Suisse et la Chine en 2014, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes.»
Niklaus Mueller loue en particulier l'esprit d'entreprise de son pays hôte: «La Chine passe pour un pays d’imitateurs. Mais elle a gagné une position de leader dans certains secteurs tels que le commerce électronique et les FinTech. Si vous prenez les entreprises technologiques aux États-Unis, vous avez souvent l'équivalent en Chine.» Et de citer Alibaba Taobao, WeChat et Didi Kuaidi, autant de réponses chinoises à eBay, WhatsApp et Uber.
Il est également impressionné par les solutions technologiques disponibles pour les petites entreprises, comme les applications de paiement par téléphone utilisées par tout le monde et disponibles en Chine depuis des années, alors qu’elles sont encore nouvelles en Suisse.
Une immersion fascinante
«Les Chinois sont très à l'aise avec les notions d’incertitude et d'ambiguïté, alors qu’en Suisse, nous voulons nous assurer de tous les détails. Nous n'aimons pas beaucoup avoir trop de questions ouvertes», note Niklaus Mueller.
Y a-t-il des choses qu'il n'aime pas en Chine? Niklaus Mueller se montre prudent. Il ne veut pas risquer d'offenser ses hôtes: «Il y a des masses de gens; les rues sont bondées; le métro est saturé. Mais je suis à l’aise avec cela parce que vous ne pouvez pas les changer.» Autocensure? Niklaus Mueller fait en tout cas preuve de diplomatie. Ce qui va sûrement l'aider à aller de l'avant dans ses affaires.
Cela ne l’empêche pas de constater les progrès à accomplir en matière d’environnement. Chaque matin, il consulte une application indiquant le taux de pollution l’air.
«Trop souvent, la qualité de l'air est mauvaise. Parfois, vous ne voyez pas à plus de 100 mètres. C’est pire en hiver qu'en été. Il y a des jours où vous ne pouvez pas poursuivre vos activités en plein air, tellement la pollution est importante», relève Niklaus Mueller qui éprouve parfois le manque de la nature suisse.
«Mais il y a aussi des signaux positifs, souligne-t-il. La Chine a consenti d'importants investissements dans les énergies renouvelables et pris des engagements lors de la Conférence sur les changements climatiques des Nations Unies à Paris, l’année dernière.»
Avenir radieux
Shanghai étant une mégapole cosmopolite, Niklaus Mueller n'a pas éprouvé de choc culturel extrême, même s’il lui est difficile de trouver des chaussures à sa taille 45. Mais il se souvient d'une situation inattendue lors de l'achat d'une crème hydratante.
«Je savais que pour les Chinoises, il est très important d'avoir la peau très blanche. On trouve donc beaucoup de crèmes blanchissantes. Mais il y a aussi une variété incroyable de produits éclaircissants pour les hommes. Personne ne m'en avait parlé. Mais apparemment, cela compte beaucoup pour eux», rigole Niklaus Mueller.
Avec ou sans crèmes spéciales, l'avenir est brillant, selon l’avocat: «Les Chinois sont optimistes. Ils savent que leur temps est venu et qu'ils ont un bel avenir économique.» Ce qui est particulièrement visible à Shanghai. «C’est incroyable d'être ici et d’y vivre une expérience de première main.»
Trouve-t-il difficile de s’intégrer? «Si vous voulez vivre en Chine, vous devez vraiment être prêt à plonger dans sa culture. Voilà pourquoi il est important d'essayer de comprendre la civilisation chinoise, son histoire, et sa langue.»
Mais il concède que Shanghai est une ville très internationale qui contraste avec certains endroits qu'il a visités dans les campagnes chinoises: «Shanghai est en quelque sorte une bulle. Elle n’est pas typique de la Chine.»
L’année prochaine, Niklaus Mueller sera diplômé de son programme MBA. Après cela, il ne sait pas encore ce qu’il fera. Il est curieux, mobile, et dispose d'un ensemble de compétences qui pourraient lui permettre d’aller à peu près partout.

Les soeurs Blaettler
Sœurs swahiliesL’éléphant dans la pièceAnand Chandrasekhar (texte), Georgina Goodwin (photos)
Blaettler sisters Art africain
Blaettler sisters Art africain


«Je ne pouvais plus vivre en Suisse. Je m’y sentais énormément sous contrôle», déclare Daniela Blaettler. Née à Lugano, cette femme de 52 ans vit désormais sur l’île de Lamu, au nord du Kenya.
Son père était d’Airolo, tout au nord du canton du Tessin, et sa mère de Pontresina, dans le canton des Grisons. A 19 ans, elle a quitté sa maison et une famille aimante pour le soleil de Saint-Tropez. Bien qu’issue d’une famille très unie comprenant trois sœurs et un frère, l’envie d’échapper à son pays natal était trop forte.
«La Suisse est très belle, mais j’avais besoin de quelque chose de plus que juste la beauté. J’étais à la recherche de défis, car la vie était trop facile pour un jeune en Suisse», dit-elle.
Même la très glamour Saint-Tropez ne pouvait satisfaire Daniela. Après sept ans sur la Côte d’Azur, où elle travaillait dans le magasin d’une amie et vendait des maisons, elle a commencé à avoir la bougeotte. C’est alors qu’un rendez-vous chez son coiffeur a débouché sur un changement de vie. En feuilletant le magazine «Paris Match», ses yeux ont été attirés par des gens chevauchant des éléphants africains.
«J’ai toujours rêvé d’avoir un éléphant dans mon jardin plutôt qu’un chien, confie-t-elle. Quand j’ai vu cette image, ça a rallumé mon rêve. J’étais fatiguée de Saint-Tropez et prête pour un changement.»
Elle a alors fait quelques recherches et découvert que la photo avait été prise dans un centre de réhabilitation pour éléphants au Botswana. Elle a immédiatement écrit une lettre au propriétaire. Un an plus tard, elle recevait une réponse l’invitant à travailler au camp. C’est ainsi qu’a commencé une autre aventure dans une existence itinérante.»
«Nous faisions des films, des publicités et des safaris pour voir les éléphants. L’objectif du projet était de sauver des éléphants à problème dans des zoos du monde entier et de les rendre à l’état sauvage en Afrique», explique-t-elle.
Une fratrie, plusieurs destins
Plusieurs années plus tard, la sœur de Daniela, Marina Oliver Blaettler, rêvait elle aussi de s’évader de Suisse. Toutefois, contrairement à sa sœur, ses rêves n’étaient pas ceux d’une adolescente en quête de nouveaux horizons. Agée à l’époque de 34 ans, elle travaillait dans une société de logiciels et menait une vie confortable.
«Je me suis réveillée un matin et j’ai décidé que ce n’était pas quelque chose que je voulais faire pour le reste de ma vie, dit cette femme aujourd’hui âgée de 56 ans. Je me sentais enchaînée et la Suisse était trop petite pour moi.»
Marina voulait voyager à travers le monde. Son plan était de s’arrêter d’abord en Afrique, pour voir sa sœur, puis de continuer. «Nous étions très semblables, ma sœur et moi. Nous avions le même cœur», dit Daniela.
Au début, la décision des deux sœurs de quitter l’Europe pour l’Afrique fut un choc pour leur famille. Mais elles ont reçu beaucoup de soutien. «Mes parents ne m’ont jamais donné d’argent, mais ils m’ont dit que j’aurais toujours leur amour et une chambre dans leur maison si jamais je revenais. Cela m’a donné la force de partir», déclare Daniela.
«Ma mère aurait probablement fait la même chose si elle avait été de notre génération, ajoute Marina. Mon père était très suisse, mais il comprenait notre besoin d’explorer le monde.»
Les autres membres de la fratrie n’étaient pas aussi aventureux. Leur seul frère est allé en Espagne, mais leur sœur aînée est restée à Lugano, où elle est parfaitement heureuse.
«Elle vit à 200 mètres de la maison de ma mère, indique Daniela. Elle a un mari, trois enfants et un chien. Tout le monde n’a pas besoin de quitter la maison.»
Vivre pleinement sur la côte kenyane

Galerie de photosVivre pleinement sur la côte kenyane
(Images: Georgina Goodwin)
Réalité africaine
Réalité africaine


Pendant que Daniela était très occupée par son travail avec les éléphants, Marina s’est vu offrir un job pour faire tourner le camp. C’était une opportunité qu’elle sentait ne pas pouvoir refuser.
«Je suis retournée en Suisse pour vendre ma maison, ma voiture et tout le reste, puis je suis revenue au Botswana», dit-elle.
Le travail au camp occupait les deux sœurs, mais leur séjour conjoint au Botswana ne pouvait pas durer toujours. Lors d’un voyage de reconnaissance au Caire, pour préparer le transport de deux éléphants par la route, Marina a été frappée par l’abjecte pauvreté rencontrée en route.
«Voir autant de gens sur le bord de la route m’a fait comprendre que je ne pouvais justifier de récolter autant d’argent pour les éléphants, alors qu’il y avait d’autres priorités pour le continent», explique-t-elle.
Daniela a aussi connu un moment de désillusion quelques années plus tard, lorsqu’un éléphant qu’elle aimait a été enchaîné. «Je leur ai dit que je ne reviendrais que lorsque mon éléphant serait rendu à la nature. Deux ans plus tard, je suis retournée pour le voir libre dans la nature. Je l’ai suivi pendant trois mois pour être sûre qu’il allait bien, puis je suis rentrée au Kenya où j’avais commencé une nouvelle vie», confie-t-elle.
Recommencer
Daniela est tombée amoureuse d’un biologiste marin anglais rencontré à Nairobi. Mais cette histoire n’était pas possible. «C’était un homme merveilleux. J’en ai encore le cœur brisé», dit-elle.
Pour récupérer de ce choc émotionnel, elle a accepté la mission de photographier des pêcheurs de l’île de Lamu, au Kenya. Elle a été enchantée par l’endroit et la communauté de pêcheurs.
«Lamu est le plus bel endroit sur Terre. Il n’y a pas de voitures, pas de discos, pas de casinos. C’est encore vierge. Ici, je suis tout le temps amoureuse», dit-elle.
Mais pour les pêcheurs locaux, la vie n’est pas toute rose. La concurrence avec les grands bateaux de pêche et les eaux dangereuses durant la saison des pluies font qu’il est difficile de gagner sa vie. L’un de ces pêcheurs, Ali Lamu, a approché Daniela pour un travail. Elle s’est alors demandé comment elle pourrait lui venir en aide et est revenue avec une idée créative.
«J’étais intriguée par le matériel utilisé pour les voiles de leurs bateaux, explique-t-elle. J’ai dessiné un grand cœur dessus, j’ai ajouté la phrase ‘Love Again Whatever Forever’ et je l’ai encadré.»
Elle a ensuite demandé à une amie de présenter cette création dans sa boutique et cela s’est vendu en seulement une heure au prix de 180 euros (193 francs). Avec l’aide des pêcheurs, Daniela a en confectionnées plusieurs autres. Et bientôt, le succès a été suffisant pour lancer un commerce d’objets d’art et de sacs faits à partir de voiles de bateaux de pêche recyclées.
Daniela a baptisé la marque Alilamu, du nom du pêcheur. Aujourd’hui, cette affaire emploie 30 personnes à temps complet, y compris Ali Lamu, qui en est désormais le directeur.
«Ali Lamu est mon pilier, mon ami, mon frère et mon plus grand soutien», dit Daniela.
La vie de ce dernier a aussi changé depuis qu’il a approché la Tessinoise pour un travail. «Désormais, j’ai construit une petite maison pour ma famille et je peux envoyer mes enfants à l’école. Quand j’étais pêcheur, je louais une pièce et je devais lutter pour payer le loyer», dit-il.

Galerie de photosTrouver l'accomplissement chez les Maasaï de Tanzanie
(Images: Georgina Goodwin)
Art de Tanzanie
Art de Tanzanie


«Ce que j’aime dans ce pays, c’est sa diversité, avec ses montagnes, ses savanes, ses forêts. Le Botswana était beau, mais complètement plat», dit-elle.
Elle est tombée amoureuse et a épousé Paul Oliver, un vieux briscard de l’Afrique, et s’est occupée avec succès de son camp de safari près d’Arusha, dans le nord du pays. Toutefois, elle n’était pas totalement convaincue par son travail et une nouvelle opportunité s’est offerte sous la forme d’une proposition passionnante d’une amie qui dirigeait une ONG à Milan.
«Elle m’a demandé si je souhaitais travailler pour un projet destiné à fournir un revenu aux femmes Massaïs en commercialisant leurs colliers en perles. J’ai accepté le job, à condition que le projet devienne un jour autosuffisant.»
Deux ans plus tard, le projet est devenu une société indépendante appelée Tanzania Maasai Women Art, avec 200 femmes qui y collaborent. Ces femmes mettent de côté 10% des revenus du groupe pour du travail de développement, comme la réparation de cases», explique Marina.
«Environ 99% des femmes sont illettrées et vivent dans la pauvreté, poursuit-elle. Je ne peux pas changer radicalement leurs vies, mais au moins, l’argent provenant de leur artisanat améliore leur confiance et leur estime de soi.»
Elles ont des vies difficiles. Les femmes Massaïs doivent collecter du bois et de l’eau pour cuisiner pour la famille et ensuite s’occuper du bétail. Leur avis n’est généralement pas pris en compte dans les décisions de la communauté et elles souffrent souvent de violences physiques.
Il a fallu un an à Marina pour gagner leur confiance. Elle espère qu’un jour, les femmes Massaïs feront tourner elles-mêmes leur commerce et qu’elle pourra alors lever le pied pour s’engager dans son prochain projet, un centre proposant de la thérapie équestre pour enfants handicapés.
«Marina est une personne de caractère. Elle aime ce qu’elle fait et elle est très encourageante. Les femmes sont très heureuses lorsqu’elles ont de nouvelles commandes», déclare la Massaï Margaret Gabriel, qui était responsable des ventes jusqu’en avril 2016.
La Suisse? Trop de règles
La Suisse est très éloignée de l’esprit des deux sœurs, bien qu’elles visitent leur mère patrie une fois par an.
«Lorsque je suis en Suisse, je me sens comme dans un lieu de vacances. Tout est tellement propre et organisé», commente Daniela.
Elle passe ses vacances à manger de la nourriture suisse, à marcher en montagne et à faire du shopping.
«Je me sens plus swahili que suisse, estime Daniela. J’apprécie quand les gens arrivent à l’heure, mais s’ils ne le sont pas, ce n’est pas bien grave.»
Daniela est intégrée dans la communauté locale de Lamu et a adopté quatre enfants du lieu âgés de 3 à 18 ans. Elle a reçu le nom local de Khalila.
«Lamu est un endroit très beau et paisible et donc très bon pour la santé, le cœur et l’âme, estime-t-elle. Je me réveille, je marche vers la plage pour voir le lever et aussi le coucher du soleil. Mais dans le même temps, je peux aussi prendre un train et me rendre en un lieu fréquenté si je veux faire des affaires.»
Bien que le chocolat suisse lui manque, Daniela affirme qu’elle ne pourrait plus vivre en Suisse, car elle s’y sent beaucoup trop sous contrôle.
«Il y a tellement de panneaux qui vous disent quoi faire ou ne pas faire, commente-t-elle. A Lamu, nous sommes si libres, malgré tous les dangers qui nous entourent.»
Les Schebabs constituent une menace constante. Ce groupe terroriste a déjà perpétré plusieurs attaques dans la région près de Lamu. La Somalie n’est pas très loin.
«Il n’y a pas d’attaques des Shebabs sur les îles, mais vous verrez les forces de sécurité sur les routes, les places et les grands hôtels, depuis que la menace a émergé, il y a quelques mois», indique son partenaire en affaires et ami Ali Lamu.
Ce dernier est également préoccupé par les responsabilités qui incombent à Daniela, comme prendre quatre enfants du lieu sous son aile. «Elle a un grand cœur, mais quelques fois elle est seule et elle a besoin que quelqu’un l’aide, comme lorsque sa fille adoptée était malade.»
Tente et espaces ouverts
La vie de sa sœur Marina est aussi à mille lieues d’une existence suisse typique. Elle vit dans une tente de style mongol, sur la ferme d’amis, avec un cheval, deux chiens et un âne.
«La Suisse rend claustrophobe. J’aime les espaces ouverts d’ici: les montagnes, les forêts et la savane», dit-elle.
Les journées de Marina suivent rarement un horaire fixe étant donné que son travail – et la vie en Tanzanie en général – réserve régulièrement des surprises. Mais elle apprécie de faire quelques activités lorsque les choses ne sont pas si chaotiques.
«Je commence ma journée avec une promenade à cheval et ensuite de vais au magasin et au bureau à Arusha. Je rentre le soir et je vais faire une longue ballade avec mon chien, regarder le coucher du soleil et quelques fois boire un verre ou manger avec mes amis», raconte-t-elle.
Contrairement au Botswana, il n’y a pas ici d’animaux sauvages dangereux, comme des lions ou des léopards, mais seulement de plus petits prédateurs comme les hyènes et chacals. Marina peut donc se promener en toute liberté. Mis à part les animaux, la zone est aussi le lieu de vie des Massaïs, un peuple dont les cases parsèment les environs. Le week-end, elle prend son vélo et se rend dans les villages pour parler avec les gens d’opportunités d’affaires.
Toutefois, l’Afrique n’est pas seulement une carte postale. «Beaucoup de gens m’envient pour ce que je vis en Afrique, mais les choses peuvent y être difficiles, rappelle-t-elle. Les choses tombent en panne et il y a beaucoup de bureaucratie et de corruption.»
Elle est également séparée de son mari et assez souvent seule, mis à part quelques amis. Toutefois, elle ne pense pas qu’elle pourrait retourner en Suisse à ce stade.
«La Suisse est une petite île et cela se voit dans la manière dont les gens pensent, juge-t-elle. Cela s’arrête aux frontières.»
Malgré tout, la neige et le ski, ainsi que le sens de l’organisation suisse lui manquent. «C’est très difficile de faire des produits pour le premier monde dans des conditions du tiers monde. La lenteur des Tanzaniens peut être parfois frustrante», confesse-t-elle.
Un avenir fragile?
Son ancienne collègue Margaret Gabriel s’inquiète pour elle. Elle estime que Marina travaille trop dur et qu’elle en fait trop. Elle s’inquiète aussi pour l’avenir de l’entreprise dans laquelle Marina a tellement investi.
«Elle doit penser à la prochaine génération, car certaines femmes prennent de l’âge et ne voient plus assez bien pour enfiler les perles, dit Margaret Gabriel. Elle doit lancer des projets avec de jeunes filles pour assurer l’avenir de l’entreprise.»
Malgré la grosse charge de travail et la responsabilité de 200 femmes Massaïs sur les épaules, Marina n’a pas de regrets. «Je vis mes rêves, dit-elle. J’ai tout ce dont j’ai besoin et je n’ai pas beaucoup d’argent. Je suis vraiment en paix, ce qui était mon objectif dans la vie.»
Sa sœur Daniela a quelques conseils pour les compatriotes suisses qui rêvent de partir un jour de leur pays. «Mes amis me jugent courageuse, mais je ne comprends pas. C’est plus courageux de rester en Suisse pour le reste de votre vie. Suivez votre cœur, n’ayez pas de craintes ou des préoccupations à propos de l’argent. Tout est possible si vous avez un cœur ouvert.»

Silvia Brugger
Silvia BruggerLa lettre d'une Suissesse qui a émigré en AlaskaPhilipp Meier (texte), Trent Grasse (photos)
Silvia Brugger Aventures en Alaska
Silvia Brugger Aventures en Alaska


Voici en résumé l’histoire de ma vie. C’est la première fois que je fais quelque chose comme ça et je ne sais pas vraiment par quoi commencer.
Silvia Brugger débute ainsi le long texte dans lequel elle raconte sous forme de lettre comment elle a émigré en Alaska. Nous nous sommes rencontrés comme on le fait aujourd’hui: en ligne – dans ce cas précis sur Facebook.
Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.
J’ai eu la chance qu’elle réponde à l’appel que j’avais lancé sur ce média social. Une de ses anciennes camarades de l’école de commerce de Lucerne lui a signalé mon post. Elle a alors produit tout naturellement ce qu’on appelle aujourd’hui du «user generated content», autrement dit, elle a raconté elle-même son histoire. Je me suis simplement permis de demander quelques précisions, insérant mes questions et ses réponses dans son texte.
Je suis née en 1974 à Cham/ZG où j’ai passé mon enfance.
J’ai quatre frères et sœurs – Max est mon jumeau et les autres ont quatre et huit ans de plus que moi (mes sœurs aussi sont des jumelles).
Toute petite déjà, et après comme teenager, j’ai beaucoup voyagé en Europe. Mes grands-parents habitaient dans le nord de l’Allemagne et notre famille possédait des chevaux islandais avec lesquels mes sœurs et moi avons participé presque chaque année à des tournois à l’étranger.
Après l’école secondaire, je suis entrée à l’école de commerce de Lucerne dans l’idée d’aller travailler chez Swissair. Mais entretemps, j’ai décidé de partir à l’aventure. Après une école de langue à Perth, j’ai traversé toute l’Australie avec une copine. Nous avions à peine 18 ans.
Mais il fallait aussi penser à ma carrière. J’ai finalement fait mon apprentissage de commerce au Carlton Elite Hotel de Zurich et j’ai ensuite été engagée de manière saisonnière au Badrutt’s Palace Hotel de St. Moritz.
Quelles leçons as-tu tirées de ton passage au Palace Hotel?
Laisse-moi réfléchir. Tout est un peu confus, peut-être parce que je sortais presque tous les soirs et que j’ai bu bien trop de bière J.
Je dirais que j’ai appris en Suisse des choses qu’on ne trouve pas toujours ici en Amérique: la discipline et la responsabilité individuelle. Elles sont toutes deux nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle.
Par exemple, ici aux USA, ce business avec les plaintes me rend folle. Quelqu’un commande un café au McDonald, se brûle la langue, porte plainte et touche un million de dollars de dédommagement ????? Je ne comprends pas. Maintenant, c’est courant, ces histoires – il n’y a plus de bon sens.
Lors d’un voyage au Canada 1997, j’ai fait connaissance avec la famille Willis, d’Anchorage, qui avait non seulement des chevaux islandais, mais aussi des chiens de traîneau. Bernie et Jeanette Willis m’ont spontanément invitée à passer quelques semaines en Alaska. C’était la première fois que j’y allais.
Après une dernière saison au Palace Hotel, j’ai émigré en Alaska en 1999 et j’ai épousé Andy la même année (le fils aîné de Bernie & Jeanette).
En 2001, Andy et moi avons monté notre propre Lodge. Nous avons acheté le terrain et le bâtiment dans une vente aux enchères et nous l’avons vidé, nettoyé, réparé et rénové pendant un an.
Mon propre Lodge de pêche et de chasse: c’était un rêve d’enfance et je n’avais jamais pensé que je le réaliserais. Ma vie était maintenant pleine d’aventures: un Lodge à nous, pêcher pendant tout l’été, chasser au printemps et en automne et, en hiver, entraîner les chiens de traîneau.
Andy et sa famille se sont toujours beaucoup engagés pour l’Iditarod, la course de traîneaux célèbre dans le monde entier. Au fil des ans, tous les hommes de la famille y ont participé. En 2007 et 2008, nous avions un équipage de chiens plutôt bon – et c’était maintenant mon tour de les conduire sur les 1000 miles de ce parcours. J’ai été la première Suissesse à participer à l’Iditarod.

Galerie de photosMa vie en Alaska
(Images: Trent Grasse)
Qu’est-ce qui te fascine dans les chiens d’attelage et les courses de traîneaux?
Qu’est-ce qui te fascine dans les chiens d’attelage et les courses de traîneaux?


J’ai toujours aimé m’occuper des animaux. Dans l’appartement où j’ai grandi, nous ne pouvions avoir que deux chats – nous avons eu notre premier chien (un Golden Retriever) quand nous avons déménagé dans une maison. J’avais environ 16 ans.
Il est clair qu’on ne peut pas comparer les chiens de traîneau avec les chiens de compagnie – ce sont des «chiens de travail». Ils ont été élevés depuis des générations pour tirer des attelages et pour travailler.
Mais c’est tout simplement magnifique de sortir avec les chiens = sur 30 ou 40 miles J.
Je suis quelqu’un qui aime bouger et j’aime aussi les défis. C’est pourquoi je ne voulais pas seulement m’amuser avec les chiens et j’ai assez vite participé à de petites courses (200 ou 300 miles). Pour le faire, j’ai formé une équipe d’une vingtaine de chiens avec lesquels j’ai plus tard fait l’Iditarod. Les préparatifs ont duré sept ans au total. J’ai moi-même élevé tous les chiens et nous les avons entraînés avec mon mari
Vous ressentez toutes sortes de choses bien différentes quand vous sortez avec les chiens! C’est une vraie aventure qui peut parfois aussi être dangereuse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller de travers. On se perd facilement dans ces régions sauvages. Il arrive aussi que des élans deviennent agressifs et attaquent les chiens, les blessant ou même les tuant. Et, évidemment, il y a le froid: il n’est pas rare que les températures descendent jusqu’à – 30 ou – 40 degrés. De novembre à janvier, les jours sont très courts (de 10h00 à 15h00) alors qu’il faut s’entraîner de huit heures du matin à six heures du soir. C’est pénible.
Mais ce travail exigeant en vaut la peine! Quand l’hiver est plus avancé (en février et en mars), les jours s’allongent. Dans les années normales, les conditions de neige sont idéales et les températures sont agréables (– 10 ou – 20 degrés). Quand c’est comme ça, je ne peux rien m’imaginer de plus beau que de sortir pour un «run» avec une douzaine de chiens au top de leur forme. C’est le calme absolu, vous n’entendez rien d’autre que la respiration des chiens! J’en ai la chair de poule. Quand vous êtes dehors la nuit, vous pouvez souvent voir des aurores boréales.
Et participer à une course est bien sûr aussi un défi personnel – surtout lorsque elle est légendaire comme l’Iditarod! 1000 miles, c’est un sacré parcours. Selon le temps et les conditions, le vainqueur met environ neuf jours. Terminer la course est la véritable récompense du travail accompli.
Il m’a fallu 10 jours pour faire les 1000 miles. Tu peux voir les détails sur internet sous www.iditarod.com (tu trouveras mon nom, Silvia Willis, dans les archives pour les années 2007 et 2008).
2007 a été ma «rookie year» (rookie = quelqu’un qui participe pour la première fois à une compétition).
Chaque jour est une nouvelle aventure et, en tant que Rookie, tu ne sais jamais ce qui t’attend. Le temps n’était pas si mauvais. Mais ça a été une des années les plus froides – beaucoup de participants (chiens & hommes) ont eu des problèmes d’engelures. A l’arrivée, tout mon visage était enflé. J’ai aussi eu une mauvaise infection à la main gauche qui m’a valu un coup de scalpel d’urgence à un checkpoint. Celui qui m’a soigné n’était pas médecin, mais un volontaire qui mettait gratuitement son temps à disposition et avait une petite trousse de premiers secours.
Mais à la longue, cette vie a fini par être trop stressante pour notre couple et Andy et moi nous sommes séparés. J’ai quitté «le monde sauvage» pour aller m’installer en ville et je mène maintenant une vie «civilisée».
J’ai beaucoup aimé les courses de traîneaux et je les regrette. Mais la vie avec les chiens était aussi très exigeante. Nous ne pouvions pas partir en vacances parce qu’il fallait les nourrir tous les jours. Et l’été, quand nous faisions une pause dans l’entraînement (il faisait trop chaud), c’était la haute saison pour notre Lodge.
Maintenant, je travaille comme Beer Sales Team Leader pour K&L Distributors et j’ai six employés.
Que fais-tu exactement?
K&L distributors Inc. est une entreprise de distribution de boissons alcoolisées en Alaska. Je suis responsable de la vente de bière pour environ quatre-vingts magasins d’alcool à Anchorage, Wasilla et Palmer.
Voici probablement plus d’informations que tu n’en avais besoin, mais j’espère que cela te donne une idée de mon histoire.
Quels aspects de la Suisse te manquent ici?
Beaucoup de choses. Comparés à l’Alaska, les transports publics suisses sont imbattables. L’Alaska est si vaste qu’il serait impossible de les financer. Je regrette aussi les nombreux chemins de randonnée qu’il y a en Suisse. Il y a beaucoup de nature et de montagnes en Alaska, mais tout est tellement isolé et peut devenir si dangereux (animaux sauvages). En tant que Suissesse, je suis naturellement gâtée avec le chocolat – je m’en bourre les poches quand je suis en Suisse avant de prendre l’avion pour rentrer chez moi en Alaska.
Je compare souvent l’Alaska et la Suisse et je me demande où je préfèrerais passer le reste de ma vie. Est-ce qu’il me faut rentrer en Suisse pour être plus près de ma famille? Où est-ce que j’aurai les meilleures conditions économiques et le meilleur système de santé? Et d’autres questions encore. Il est difficile de trouver la «bonne» réponse. Les deux pays (USA et CH) ont leurs côtés positifs et leurs côtés négatifs. Ce n’est pas facile de faire la part des choses.
Aux USA, il est plus simple de réaliser mes rêves et d’être libre. Quand j’écris «USA», je veux dire Alaska. Je ne pourrais pas m’imaginer vivre dans de grandes villes telles que New York, Los Angeles ou Chicago. L’Alaska est comparable à la Suisse – j’aime surtout les montagnes.
Je trouve que la Suisse est très règlementée – l’Etat prescrit trop de choses. La Suisse est relativement petite et elle est très peuplée – je deviens claustrophobique quand j’y retourne.
Comment entretiens-tu le contact avec tes amis et ta famille en Suisse?
Pratiquement plus que par Facebook – et j’aime vraiment ça! C’est bien de pouvoir y suivre ce que mes anciens camarades de classe sont devenus. Sans Facebook, je n’en aurais pas la moindre idée. Et «Hangouts» me permet d’être régulièrement en contact avec mon père et avec mes frères et sœurs. Tous les deux mois, nous nous y retrouvons en ligne le dimanche matin.
Je vis aux USA depuis 17 ans – et même si l’Amérique n’est pas parfaite, c’est plus facile pour moi de réaliser mes rêves ici. Je ne sais pas comment le dire mieux – je ne trouve pas les mots. En Suisse, tout était déjà planifié: école, apprentissage, recherche d’un emploi, puis travailler toute sa vie et économiser pour la retraite.
La situation économique et politique de l’Europe m’inquiète plus que celle de l’Amérique. Mais le monde entier est en mutation. Nous sommes tous touchés, où que nous vivions. En Alaska, nous dépendons des ressources naturelles et nous luttons actuellement avec un gigantesque déficit budgétaire qui atteint plusieurs milliards de dollars. L’avenir est incertain et tout le monde est inquiet. Mais la situation en Europe me préoccupe aussi. C’est pourquoi je crois que c’est une bonne chose que la Suisse ne soit pas entrée dans l’UE. Cela la protège un peu des influences économiques négatives. Mais la Suisse est en Europe, elle est entourée par des Etats de l’EU et elle subit leur influence.
Je n’ai pas quitté la Suisse parce que je ne m’y plaisais pas. J’ai eu l’occasion d’élargir mon horizon et je l’ai saisie. Je suis fière de mes origines, j’aime ma patrie et j’aime bien aller en Suisse – mais à la fin de chaque visite, je me réjouis de retourner «chez moi» en Alaska.

Les Hostettlers
Christine & Hans HostettlerDe l'Oberland bernois à la forêt paraguayenneMarcela Aguila (texte), Rodrigo Muñoz (photos)
Les Hostettlers Au paradis paraguayen
Les Hostettlers Au paradis paraguayen


«Si nous voulons revenir en Suisse? Non!», répond Christine sans hésiter. «Ici, nous avons une liberté et des possibilités de créer qu'en Suisse, nous n’aurions même pas pu imaginer».
Une liberté dont ils ont fait amplement usage: ils ont fondé une association pour la protection de la nature, un programme d'écotourisme et une ferme biologique qu'ils ont appelé ‘New Gambach’, en hommage à leur village natal. C’est là qu’ils nous reçoivent et partagent avec nous le pain, le sel, et leurs souvenirs de 36 ans en tant que citoyens de la ‘Cinquième Suisse’.
Ils nous parlent de leur nostalgie, de la famille, des amis, et de la culture suisse, de l’organisation et du «propre en ordre». Mais ici c’est malgré tout chez eux, insistent-ils. Un chez eux qu’Hans a construit de ses propres mains à Alto Vera, Itapúa, et qui jouxte la Réserve du Parc National San Rafael.
Un engagement dangereux
Une proximité qui veut dire beaucoup. L’histoire des Hostettler se confond avec celle de la défense du dernier bastion de la Forêt Atlantique au Paraguay, l'un des écosystèmes les plus riches de la planète, mais aussi l'un des plus menacés.
Et si l’on parle de dangers, Christine n’est pas près d’oublier ce dimanche de 2008: «Il y avait le football. J'étais seule dans la maison et j’ai entendu des bruits à l'extérieur. Je suis sortie et je me suis retrouvée face à face avec quelqu'un qui portait une cagoule et qui pointait un revolver 38mm dans ma direction». Christine ne sait toujours pas si c’est sa bonne étoile ou le fait que l’assaillant visait mal, mais le fait est que la balle est partie sans la toucher. De la même manière, Hans s’est en sorti indemne quand des inconnus ont tiré sur son avion alors qu’il survolait les forêts pour détecter des exploitations forestières illégales, des incendies ou des cultures illicites.
«Ils pensaient qu’en nous tuant, le combat était terminé. Ils savent que maintenant nous sommes plusieurs», affirme triomphalement notre hôtesse.
Le froid de l’Oberland
Mais revenons au point de départ de leur aventure, à la fin des années 70, dans l'Oberland bernois. La vie de la famille Hostettler s’écoule paisiblement à Gambach, commune de Rüschegg. Trop paisiblement. Quand il apprend qu’il est possible d'acquérir des parcelles de l’autre côté de l'Atlantique, le couple se dit «essayons».
Avec le soutien de la famille, ils achètent 250 hectares dans le Nouveau Monde, qui pour eux est bien un monde nouveau, mais qu’ils perçoivent comme plutôt archaïque. «Comme si nous étions il y a 50 ans», plaisante Christine, en évoquant le paradis inhospitalier dans lequel ils débarquent alors, où n’existe pas la moindre infrastructure. En Suisse, c’était le froid et la monotonie, mais au moins, il y avait le confort et la sécurité.
Christine débarque avec Brigitte, la fille aînée du couple, dans ses bras, en février 1979. Hans avait émigré six mois plus tôt pour préparer le terrain, au sens littéral du terme: l'ancien marin a dû débarrasser la zone des arbres et des mauvaises herbes pour y construire une maison en bois pour sa famille.
Très habile de ses mains, Hans consolide la maison au fil des ans, et la dote de l’électricité en érigeant un barrage, dont le lac de retenue est devenu un biotope. Sa dextérité lui permet de maintenir la moissonneuse en service et d’assembler les pièces de l’avion ultraléger reçu par la poste.

Galerie de photosLes paradis des Hostettler en pleine forêt Guarani
(Images: Rodrigo Muñoz)
Des années de lutte
Des années de lutte


Mais parallèlement, la ferme a porté ses fruits, ou plutôt son lait. Christine a appris à faire du fromage (au Paraguay, pas en Suisse), Brigitte a eu une sœur et un frère, Teresa et Pedro. Les cultures de soja biologiques marchent bien et les Hostettler se livrent pleinement à la défense de l'environnement.
En fait, l'avion, acquis avec le soutien du WWF, est un des soutiens extérieurs qu’a pu obtenir l’association Pro Cosara, qui lutte pour la défense de ce sanctuaire naturel. Née en 1997, sous l’impulsion du couple, l'organisation veille sur la zone protégée, décrétée en 1922, et tente d'acquérir des terres de propriétaires privés que le gouvernement n'a pas indemnisés.
Cette situation empêche que cette zone de 73’000 hectares devienne «parc écologique». Or celle-ci est menacée par les cultures extensives - principalement du soja, mais aussi des plantations illicites - et par l'exploitation forestière illégale.
Un nouveau front
Christine et son équipe ont travaillé sans relâche pour renforcer l’association, qui compte maintenant avec un important réseau international de soutien et de contacts. Elle met en œuvre des programmes de recherche pour l’inventaire de la réserve, ainsi que d’éducation écologique afin de sensibiliser les gens et de développer des activités durables.
Pro Cosara est en bonne voie, Christine en a quitté la direction en février, bien qu’elle fasse toujours partie du conseil. Puis, elle a ouvert un nouveau front dans la lutte pour la préservation de la nature: un projet d'écotourisme. Récemment, des étudiants des Etats-Unis sont venus ici et ont inventorié par moins de 70 espèces différentes d'oiseaux dans les alentours.
Un véritable paradis. Mais les paysages de leur Oberland d'origine sont eux aussi idylliques. Est-ce que la décision d’émigrer était la bonne? «La meilleure», répond Christine sans hésiter. En plus de la liberté, le couple se félicite de la possibilité pour leurs enfants de grandir en contact avec la nature et dans son respect.
La Suisse, toujours présente
Le foyer, la famille, la ferme, les cultures, l’engagement pour l’environnement: tout cela suffit à remplir une vie intense. Mais le pays dans lequel ils sont nés n’a jamais cessé d'y être présent.
Leurs deux filles vivent désormais en Suisse et le couple y revient régulièrement. Au Paraguay, ils participent aux activités de leurs compatriotes expatriés et Christine a travaillé pendant cinq ans, bénévolement, pour que les retraités suisses dans la région puissent continuer à recevoir leurs pensions.
Presque 40 ans après son départ, comment Christine voit-elle son pays aujourd’hui? «Il y a eu un changement radical. Ce n’est plus la Suisse de nos souvenirs. Nos parents ont travaillé pendant de nombreuses années avec des étrangers qui avaient leurs droits et ne cherchaient pas à imposer leur culture. Aujourd'hui, il semble que la situation est différente et je crains pour la perte de l'identité suisse».
Et que recommanderait-elle à ceux qui envisagent de quitter la Suisse? «Qu’avant de prendre une décision définitive, ils se rendent dans le pays choisi et y vivent pendant au moins trois mois. Il y a des gens qui envoient le conteneur à l’avance, qui dépensent leurs économies et qui réalisent trop tard que le destin choisi ne correspond pas à ce qu’ils avaient imaginé».
Malgré l’enthousiasme de leur jeunesse, les Hostettler, à l’époque n’ont pas tout pris lorsqu’ils ont quitté la Suisse. Leur mobilier, par exemple, est resté de longues années à Rüschegg. En fait, leurs derniers objets sont arrivées il n’y a pas si longtemps. Ils ont donc bien émigré, mais ils ont longtemps gardé une porte de sortie vers leur patrie natale.

Bruno Manser
Bruno ManserLe prix du retour à la simplicitéRuedi Suter (texte), Fonds Bruno Manser (photos)
Bruno Manser Disparu en Malaisie
Bruno Manser Disparu en Malaisie


«L’intérêt considérable du gouvernement malaisien et des exploitants forestiers à réduire Bruno Manser au silence est établi», écrivait fin 2003 le tribunal civil de Bâle dans la procédure de disparition. Bruno Manser, qui a grandi à Bâle, aimait la vie. Mais pas au prix de l’ignorance, de la destruction et de l’exploitation. Pas au prix de la société industrielle dans laquelle il avait grandi. Car souvent cette société vit à crédit, en exploitant les populations autochtones et la nature. Il opposait son ascétisme à la société de la surabondance: sa vie était un chemin radical vers le retour à la simplicité. C’est la raison pour laquelle il s’opposait au mode de vie moderne partout où cela était possible. Avec intelligence, créativité, entêtement et humour.
Bruno Manser renonça à des études, préférant la vie de berger et de fromager. Il passa 11 ans dans les montagnes. «Je voulais acquérir des connaissances sur tout ce que nous utilisions dans la vie de tous les jours». Il cherchait un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait de manière rudimentaire et auprès duquel il pourrait appliquer tout ce qu’il avait appris. Dans l’Europe mécanisée, il n’y avait plus aucun peuple qui correspondait à ses souhaits.
En 1984, il part donc pour Bornéo, dans l’Etat malais du Sarawak. Là-bas, il s’enfonce dans la jungle avec un courage et une audace hors du commun. Son souhait: rencontrer les 300 familles de Penans qui vivaient encore pleinement leur existence de nomades au cœur de la forêt tropicale.
Les Penans acceptent ce curieux étranger parmi eux. Bruno Manser se sépare de tout ce qu’il avait emmené avec lui: vêtements, pharmacie de secours, pâte dentifrice, chaussures. Myope, il décide toutefois de garder ses lunettes. Il se force à marcher à pieds nus, malgré les douleurs initiales, les plaies ouvertes en permanence et les épines qu’il faut régulièrement enlever au couteau. Il apprend à endurer la douleur. Celui qui comme les Penans vit dans la jungle doit en effet accepter la douleur comme une évidence. La marche à pieds nus devient une habitude, un acte de libération. Lui, l’homme de la modernité, ne dépend plus de ses chaussures. Une victoire sur lui-même!
L’un d’entre eux
Rapidement, il gagne un immense respect auprès de ses hôtes. Il s’adapte à la vie des Penans sans aucun compromis. La marche à pieds nus, la nudité, la faim, l’humidité, les insectes, les sangsues, mais aussi les ulcères de la peau et le paludisme font partie de son quotidien. Et finalement, lui, le porteur de lunettes, se déplace dans la jungle à la manière d’un Penan, se frayant un passage grâce à sa machette, se reposant dans la position accroupie des nomades. Il traverse des rivières en crue à la nage, construit son bivouac de nuit sur les cimes des arbres.
La vie simple des nomades de la forêt lui plait. C’est comme s’il avait retrouvé sa famille dans une vie antérieure. Il ne veut plus retourner en Suisse. Fini l’étroitesse, les gaz d’échappement, le bruit. Il ne veut plus faire partie de ces gens qui avec le déclin de la biodiversité s’éloignent toujours plus de la vie naturelle, qui cherchent grâce à la technologie, l’argent et l’industrie du divertissement un sens à leur vie, une vie dans laquelle ils se perdent et qui les rend de plus en plus tristes.
Non, c’est ici, auprès de ce peuple simple et chaleureux qu’il veut rester, souffrir, être heureux, et profiter de la vie offerte par la jungle. Tout cela malgré la nostalgie latente, pas celle de la Suisse, mais celle qui est éveillée par le souvenir de sa famille et de ses amis. Une douleur à l’âme qui le pousse à écrire et à envoyer régulièrement des enregistrements à la maison, mais qui ne le forcerait jamais à quitter volontairement sa nouvelle famille de la forêt tropicale. Oui, il est arrivé dans le paradis qu’il s’était imaginé! Rien ne pourra jamais le convaincre à partir d’ici.
Il était devenu pour les Penans l’un des leurs, «Laki Penan». Lui aussi ne connaissait que la nature sauvage: la pêche au filet, la chasse aux ours, aux singes, aux cochons sauvages, aux cerfs et aux oiseaux avec une sarbacane et du poison ou une lance, la cueillette des fruits sauvages et l’extraction de farine de sagou à partir des cœurs de palmier sauvages.
Il apprend la langue, note toutes ses observations, compile d’innombrables documents sur les hommes, les animaux et les plantes. Peut-être pressent-il déjà la destruction de ce monde d’arbres géants avec ses eaux claires, sa faune et sa flore d’une richesse incroyable.
La forêt est en effet détruite à de nombreux endroits par les entreprises forestières, avec la bénédiction d’un gouvernement qui ignore les droits fonciers et le sort de plus en plus précaire des habitants primitifs de la forêt. Pour les politiciens de Kuching, la capitale de la province du Sarawak, la forêt tropicale n’est qu’un supermarché en libre-service. Le bois dur et précieux des arbres géants est vendu pour répondre aux besoins des consommateurs des pays industrialisés. Il est transformé en poutres de toit, meubles, yachts de luxe, cadres de fenêtre et manches de toutes sortes.

Galerie de photosActiviste de la forêt tropicale
(Images: Bruno Manser Fund)
Ennemi d’Etat numéro un
Ennemi d’Etat numéro un


Des équipes de télévision font le déplacement pour filmer ce gardien courageux de la forêt tropicale. Aux yeux de la presse internationale, le «Blanc sauvage» est devenu le porte-parole des Penans. Il apparait sous un jour modeste, avec une voix calme et un langage honnête. Le monde entier l’écoute. Bruno Manser, l’architecte de la résistance, devient un symbole de la lutte contre la déforestation de la forêt tropicale.
«Alarmé par le fait que l’habitat des Penans était sacrifié pour permettre la production de bois bon marché à destination du marché international, je suis retourné en 1990 en Suisse pour faire entendre leur voix – ‘Ne construisez pas vos maisons à partir de nos forêts’ – dans notre civilisation». A Bâle, il fonde avec le soutien de Roger Graf, un défenseur des droits de l’homme, la puissante organisation «Bruno Manser Fonds (BMF)». L’objectif du fonds est d’inciter les consommatrices et les consommateurs des pays industrialisés à renoncer au bois tropical.
Le BMF insiste évidemment sur la symbiose entre les peuples de chasseurs-cueilleurs et leur environnement. «Lorsque la forêt meurt, les hommes meurent aussi». Doux dans la manière, mais inflexible sur ses principes, l’organisation porte devant les instances internationales telles que l’UE, l’ONU et l’OIBT, l’organisation internationale des bois tropicaux, la situation désespérée des Penans. En Suisse, Bruno Manser vit de façon très modeste, travaille énormément, voyage beaucoup. Il continue de se battre aux côtés des Penans à Bornéo pour tenter d’empêcher le massacre de la forêt. Il se radicalise, sentant que le temps est compté pour les Penans.
La trace se perd
En Suisse, Bruno Manser entame une grève de la faim très remarquée pour obtenir une déclaration obligatoire sur l’interdiction d’exporter du bois tropical. «Les repus ne veulent pas comprendre les affamés», dit-il. La forêt de Sarawak continue de disparaître, les animaux sont chassés ou braconnés. La vie du peuple des Penans devient de plus en plus précaire. En 1996, 70% de la forêt primaire a disparu. Le défenseur de la forêt tropicale fait connaître ses revendications au travers d’actions téméraires en Europe et à Sarawak. Mais rien n’y fait. En 2000, Bruno Manser se rend à nouveau à Bornéo et disparaît pour toujours.
A-t-il été assassiné et éliminé sans laisser de traces? C’est l’explication la plus plausible, mais elle n’a pas jusqu’ici pu être prouvée davantage que l’hypothèse d’un accident ou d’un suicide. Sa disparition demeure un mystère. Aujourd’hui, ses proches et ses amis ne l’attendent plus. Ils sentent sa présence, dans leurs cœurs, leurs pensées. S’il était parmi eux, il leur dirait certainement de sa voie puissante: «Seuls les actes comptent, les tiens également.»

Sur le même sujet
Toujours plus de Suisses choisissent d’émigrer
En 2018, le nombre de Suisses résidant à l’étranger a augmenté de 1,1%. La diaspora helvétique compte désormais 760'200 personnes. La destination la plus prisée des émigrés reste la France, suivie de l’Allemagne, des Etats-Unis et de l’Italie.
La Cinquième Suisse perd son doyen, Rodolphe Buxcel, 110 ans
Le doyen des Suisses de l’étranger s’est éteint aux Etat-Unis, dans le Michigan, dans sa 111e année. Né en 1908 dans une colonie suisse de la Russie tsariste, Rodolphe Buxcel emporte avec lui le souvenir de plus d’un siècle d’histoire.
Comment les Suisses de l’étranger s’informent sur leur patrie d’origine
Télévision par satellite ou via Internet, sites d’information gratuits ou «paywall» des principaux quotidiens helvétiques: à l’occasion de la votation sur «No Billag», nous avons demandé à nos abonnés sur Facebook quelles étaient leurs sources d’information privilégiées pour rester au contact de l’actualité suisse. Petit florilège.
Un Suisse parmi les derniers nomades Penan
Le photographe Tomas Wüthrich pose un regard intime sur la vie des Penan, indigènes de la forêt équatoriale du Sarawak. De la chasse à la sarbacane à l’avancée de la déforestation, ses images racontent le quotidien d’un mode de vie menacé. «Mais je ne suis pas le nouveau Bruno Manser», précise-t-il. Rencontre.

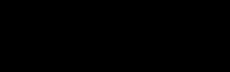






















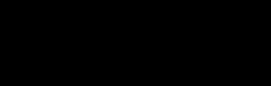 Fuir la Suisse, cette cage dorée
Fuir la Suisse, cette cage dorée
 La passion chinoise de Niklaus
La passion chinoise de Niklaus
 Niklaus Mueller
Niklaus Mueller
 Un étudiant bernois à Shanghai
Un étudiant bernois à Shanghai
 Le filet de sécurité suisse
Le filet de sécurité suisse
 L’éléphant dans la pièce
L’éléphant dans la pièce
 Blaettler sisters
Blaettler sisters
 Vivre pleinement sur la côte kenyane
Vivre pleinement sur la côte kenyane
 Réalité africaine
Réalité africaine
 Trouver l'accomplissement chez les Maasaï de Tanzanie
Trouver l'accomplissement chez les Maasaï de Tanzanie
 Art de Tanzanie
Art de Tanzanie
 La lettre d'une Suissesse qui a émigré en Alaska
La lettre d'une Suissesse qui a émigré en Alaska
 Silvia Brugger
Silvia Brugger
 Ma vie en Alaska
Ma vie en Alaska
 Qu’est-ce qui te fascine dans les chiens d’attelage et les courses de traîneaux?
Qu’est-ce qui te fascine dans les chiens d’attelage et les courses de traîneaux?
 De l'Oberland bernois à la forêt paraguayenne
De l'Oberland bernois à la forêt paraguayenne
 Les Hostettlers
Les Hostettlers
 Les paradis des Hostettler en pleine forêt Guarani
Les paradis des Hostettler en pleine forêt Guarani
 Des années de lutte
Des années de lutte
 Le prix du retour à la simplicité
Le prix du retour à la simplicité
 Bruno Manser
Bruno Manser
 Activiste de la forêt tropicale
Activiste de la forêt tropicale
 Ennemi d’Etat numéro un
Ennemi d’Etat numéro un
 Entretien.
Entretien.
 Etaucher sa soif.
Etaucher sa soif.
 Réflexion.
Réflexion.
 Souvenir, souvenir.
Souvenir, souvenir.
 Connecté.
Connecté.
 Aux abords de la maison de Daniela à Malindi.
Aux abords de la maison de Daniela à Malindi.
 Home sweet home.
Home sweet home.
 Au repas du soir, famille et collègues se retrouvent.
Au repas du soir, famille et collègues se retrouvent.
 Sur le chemin de l'école pour y chercher ses enfants.
Sur le chemin de l'école pour y chercher ses enfants.
 Sa maison fait aussi office d'atelier.
Sa maison fait aussi office d'atelier.
 Daniela passe du temps avec ces enfants adoptés.
Daniela passe du temps avec ces enfants adoptés.
 En pleine confection de sacs.
En pleine confection de sacs.
 Daniela a un faible pour les coeurs.
Daniela a un faible pour les coeurs.
 L'atelier est toujours une ruche.
L'atelier est toujours une ruche.
 Daniela prend une pause pendant que Shueb prépare le dîner.
Daniela prend une pause pendant que Shueb prépare le dîner.
 En famille de retour de l'école.
En famille de retour de l'école.
 Daniela et ses enfants.
Daniela et ses enfants.
 Chaque lundi matin, nous avons une séance avec toute l’équipe des ventes et nous planifions les activités pour la semaine à venir.
Chaque lundi matin, nous avons une séance avec toute l’équipe des ventes et nous planifions les activités pour la semaine à venir.
 Discussion avec un bon client, Bryan Swanson, qui possède trois magasins de boissons.
Discussion avec un bon client, Bryan Swanson, qui possède trois magasins de boissons.
 En 2015, K&L Distributors a acheté environ 2,7 millions de caisses de bière.
En 2015, K&L Distributors a acheté environ 2,7 millions de caisses de bière.
 A l’inverse, nous avons aussi des échanges avec nos fournisseurs.
A l’inverse, nous avons aussi des échanges avec nos fournisseurs.
 Une rencontre avec les représentants de la brasserie californienne Lagunitas.
Une rencontre avec les représentants de la brasserie californienne Lagunitas.
 Je me rends le plus souvent possible dans la nature.
Je me rends le plus souvent possible dans la nature.
 Par exemple, pour pêcher à «Bird Creek».
Par exemple, pour pêcher à «Bird Creek».
 «Bird Creek» se trouve à seulement 20 minutes d’Anchorage. C'est un lieu connu pour la pêche au saumon argenté.
«Bird Creek» se trouve à seulement 20 minutes d’Anchorage. C'est un lieu connu pour la pêche au saumon argenté.
 J’ai abattu cet ours noir à Beluga, il y a environ 10 ans. Ces trois Golden Retrievers sont mes meilleurs amis.
J’ai abattu cet ours noir à Beluga, il y a environ 10 ans. Ces trois Golden Retrievers sont mes meilleurs amis.
 Seuls les «mushers», qui ont terminé l’Iditarod, une course de traîneaux célèbre dans le monde entier, ont le droit de posséder ce numéro de plaque spécial en Alaska. Le numéro 22 est celui de mon meilleur classement, en 2008.
Seuls les «mushers», qui ont terminé l’Iditarod, une course de traîneaux célèbre dans le monde entier, ont le droit de posséder ce numéro de plaque spécial en Alaska. Le numéro 22 est celui de mon meilleur classement, en 2008.
 Je fais volontiers de petites balades avec mes chiens.
Je fais volontiers de petites balades avec mes chiens.
 Les deux chiens de couleur claire s’appellent Myla (16 ans) et Oscar (le fils de Myla). Ils ne vont plus vivre très longtemps. C’est pourquoi, l’an dernier, j’ai décidé d’introduire un nouveau chien dans la famille.
Les deux chiens de couleur claire s’appellent Myla (16 ans) et Oscar (le fils de Myla). Ils ne vont plus vivre très longtemps. C’est pourquoi, l’an dernier, j’ai décidé d’introduire un nouveau chien dans la famille.
 Eloignés du monde, mais pas complètement isolés. Hans Hostettler devant sa maison avec un ami et son fidèle chien Albi.
Eloignés du monde, mais pas complètement isolés. Hans Hostettler devant sa maison avec un ami et son fidèle chien Albi.
 Christine Hostettler dans son bureau.
Christine Hostettler dans son bureau.
 Hans et Christine Hostettler organisent différentes activités d'écotourisme pour les hôtes de passage.
Hans et Christine Hostettler organisent différentes activités d'écotourisme pour les hôtes de passage.
 Christine Hostettler a appris à faire du fromage au Paraguay.
Christine Hostettler a appris à faire du fromage au Paraguay.
 Il y a plus de 35 ans que Hans Hostettler peut profiter chaque jour de la végétation luxuriante de la forêt Guaranì.
Il y a plus de 35 ans que Hans Hostettler peut profiter chaque jour de la végétation luxuriante de la forêt Guaranì.
 Les poules partagent aussi le quotidien des Hostettler.
Les poules partagent aussi le quotidien des Hostettler.
 A bord de son petit avion, Hans Hostettler survole la réserve naturelle pour découvrir d'éventuelles activités illégales.
A bord de son petit avion, Hans Hostettler survole la réserve naturelle pour découvrir d'éventuelles activités illégales.
 Le potager familial.
Le potager familial.
 Véritable artisan, Hans Hostettler a remis à neuf leur maison du Paraguay, en y apportant notamment l'eau courante et l'électricité.
Véritable artisan, Hans Hostettler a remis à neuf leur maison du Paraguay, en y apportant notamment l'eau courante et l'électricité.
 Hans et Christine Hostettler durant une promenade dans la forêt.
Hans et Christine Hostettler durant une promenade dans la forêt.
 L'heure de la pause ne peut avoir lieu sans la traditionnelle infusion de maté.
L'heure de la pause ne peut avoir lieu sans la traditionnelle infusion de maté.
 L’exploitation «Nueva Gambach» avec la maison des Hostettler, les champs et les serres.
L’exploitation «Nueva Gambach» avec la maison des Hostettler, les champs et les serres.
 En 1984, Bruno Manser se rend pour la première fois à Bornéo.
En 1984, Bruno Manser se rend pour la première fois à Bornéo.
 Il part à la recherche des Penans, un peuple nomade qui vit dans la jungle.
Il part à la recherche des Penans, un peuple nomade qui vit dans la jungle.
 Bruno Manser sur un cliché du photographe Alberto Venzago, en 1986.
Bruno Manser sur un cliché du photographe Alberto Venzago, en 1986.
 Une autre photographie prise par Venzago en 1986, dans le cadre d'un reportage pour le magazine GEO.
Une autre photographie prise par Venzago en 1986, dans le cadre d'un reportage pour le magazine GEO.
 La destruction de la forêt atteint des dimensions gigantesques.
La destruction de la forêt atteint des dimensions gigantesques.
 En mars 1993, la ministre suisse Ruth Dreifuss tricote un pull en laine avec Bruno Manser. Il sera remis en cadeau au gouvernement.
En mars 1993, la ministre suisse Ruth Dreifuss tricote un pull en laine avec Bruno Manser. Il sera remis en cadeau au gouvernement.
 Bruno Manser et Martin Vosseler durant leur grève de la faim à Berne, 7 avril 1993.
Bruno Manser et Martin Vosseler durant leur grève de la faim à Berne, 7 avril 1993.
 Manser retourne régulièrement en Europe pour faire connaître son combat en faveur de la forêt et des peuples indigènes de Bornéo. (Keystone)
Manser retourne régulièrement en Europe pour faire connaître son combat en faveur de la forêt et des peuples indigènes de Bornéo. (Keystone)
 Les Penans font également de la résistance en érigeant des barrages, comme ici aux alentours de la commune de Long Ajeng, dans l'Etat du Sarawak.
Les Penans font également de la résistance en érigeant des barrages, comme ici aux alentours de la commune de Long Ajeng, dans l'Etat du Sarawak.
 Bruno Manser chasse, pêche et vit comme un Penan.
Bruno Manser chasse, pêche et vit comme un Penan.
 Une femme Penan donne à manger à un calao dénommé "Metui" en langue Penan.
Une femme Penan donne à manger à un calao dénommé "Metui" en langue Penan.
 Ara Potong, le défunt chef de tribu des Ba Pengaran Kelian.
Ara Potong, le défunt chef de tribu des Ba Pengaran Kelian.
 Bruno Manser en compagnie du chef de tribu Penan Along Sega.
Bruno Manser en compagnie du chef de tribu Penan Along Sega.
 Peng Meggut, de la région de Limbang, mène aujourd'hui encore une existence de nomade.
Peng Meggut, de la région de Limbang, mène aujourd'hui encore une existence de nomade.
 Bruno Manser au Sarawak en 2000, peu de temps avant sa disparition.
Bruno Manser au Sarawak en 2000, peu de temps avant sa disparition.
 La forêt tropicale au crépuscule.
La forêt tropicale au crépuscule.
 Gagner la confiance des Moranes- de jeunes guerriers Maassaï - est important pour avoir accès à l’ensemble de la communauté.
Gagner la confiance des Moranes- de jeunes guerriers Maassaï - est important pour avoir accès à l’ensemble de la communauté.
 Discussion sur la conception de sac dans le nouvel atelier de cuir à Mkuru.
Discussion sur la conception de sac dans le nouvel atelier de cuir à Mkuru.
 Il faut des yeux perçants et des doigts agiles pour fabriquer des bijoux Maasaï.
Il faut des yeux perçants et des doigts agiles pour fabriquer des bijoux Maasaï.
 Gabriel est l'un des rares experts masculins dans l'entreprise.
Gabriel est l'un des rares experts masculins dans l'entreprise.
 Le centre culturel de la communauté Maasaï où Marina rencontre son équipe.
Le centre culturel de la communauté Maasaï où Marina rencontre son équipe.
 Répondre aux commandes internationales exige une planification constante de la production.
Répondre aux commandes internationales exige une planification constante de la production.
 Les jeunes seront-ils intéressés à travailler pour l'entreprise ou quitteront-ils leur tribu pour la ville ?
Les jeunes seront-ils intéressés à travailler pour l'entreprise ou quitteront-ils leur tribu pour la ville ?
 Pour se rendre à Mkuru, il faut pratiquer une route cahoteuse sur 50km.
Pour se rendre à Mkuru, il faut pratiquer une route cahoteuse sur 50km.
 La formation de nouveaux employés dans le magasin de l’entreprise à Arusha.
La formation de nouveaux employés dans le magasin de l’entreprise à Arusha.
 Vérifier la pression des pneus pour éviter de mauvaises surprises.
Vérifier la pression des pneus pour éviter de mauvaises surprises.
 A la sortie de la ferme.
A la sortie de la ferme.
 Piccola et Buffo montent la garde.
Piccola et Buffo montent la garde.
 Un habitat adapté au climat.
Un habitat adapté au climat.
 Toilettes séparées.
Toilettes séparées.
 Vue sur le bush.
Vue sur le bush.
 Rare moment de pause pour Marina.
Rare moment de pause pour Marina.
 Les visiteurs ne sont pas rares à l’atelier.
Les visiteurs ne sont pas rares à l’atelier.
 Chaque matin, la première action de Marina est de rejoindre son cheval Fizz.
Chaque matin, la première action de Marina est de rejoindre son cheval Fizz.
 Partir à la fin du jour pour de longues promenades avec ses chiens est le passe-temps favori de Marina.
Partir à la fin du jour pour de longues promenades avec ses chiens est le passe-temps favori de Marina.